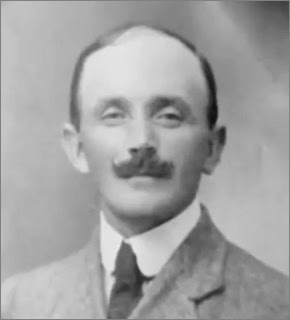Les fausses vérités de l’affaire Seznec, 2.
LE RUBAN NOIR DE LA MACHINE À ÉCRIRE
Le 6 juillet 1923, la police mobile de Rennes procède à la troisième perquisition du domicile de Guillaume Seznec à Morlaix, sur commission rogatoire du juge d’instruction Binet de Brest, comme elle l’avait fait les 28 et 30 juin, mais cette fois la fouille s’étend à tous les bâtiments de la propriété et est très approfondie. Elle est réalisée par le commissaire divisionnaire Léon Labouerie, le commissaire Jean-Baptiste Cunat et les inspecteurs François Chélin, Pierre Faggiani, Pierre Le Gall et Jules Thomas.
Denis Langlois, dans L’Affaire Seznec (1988, page 98), attribue par erreur à la seconde perquisition les opérations exhaustives uniquement effectuées le 6 juillet, comme une lecture attentive de La Dépêche de Brest du 8 juillet 1923 nous permet de le constater (je reproduis le passage concerné plus bas).
Héritant de cette confusion, Denis Seznec, dans Nous, les Seznec (1992, page 170 de l’édition de 2009), nous offre un récit très détaillé et vivant de la perquisition, comme s’il y avait assisté en personne, mais dont pratiquement chaque phrase révèle une mauvaise lecture des sources ou n’est simplement que le fruit de son imagination débordante.
Les deux auteurs ont alors à cœur de démontrer que, les policiers ayant déjà fouillé les bâtiments de Seznec de fond en comble la dernière fois, toute nouvelle découverte ne pourrait concerner qu’un objet qui y aurait été placé ensuite, alors que Seznec était à Paris.
En réalité, la machinerie n’avait pas encore été visitée. C’est au deuxième étage de ce bâtiment, dans le grenier (et non au premier étage, comme Denis Langlois et Denis Seznec l’ont écrit), que les inspecteurs Chélin et Thomas découvrent une machine à écrire de marque Royal, dissimulée « derrière un tableau de distribution d’énergie électrique, enveloppée dans un vieux tablier en toile de sac », selon une lettre du commissaire Labouerie en date du 19 octobre 1924 (citée par Bernez Rouz dans L’Affaire Quéméneur-Seznec, 2005, page 123 de l’édition de 2006). Le Petit Parisien du 25 juillet 1923 attribue cette trouvaille au seul Chélin.
Voici comment Denis Seznec nous raconte (page 173) les suites immédiates de la découverte de cet élément extrêmement important de l’affaire :
Les policiers s’emparent de la Royal, la manipulent sans aucune précaution, relèvent le numéro, puis vont la montrer à Angèle Labigou.
— Vous connaissez cette machine ?
— C’est la première fois que je la vois, celle-là ! s’exclame la bonne. Jamais on ne s’en est servi dans la maison !
Un peu plus tard, quand apparaît Marie-Jeanne, celle-ci a une réaction identique. Mais elle ajoute :
— Sur l’acte de vente de Traou-Nez, que vous nous avez pris, il y avait des lettres avec des traces rouges, je m’en souviens. Regardez, le ruban de celle-là, il est tout noir ! Il n’a pas servi à taper l’acte de vente, c’est évident.
Le commissaire Cunat hausse les épaules. Rouge, noir, quelle importance ?
Habitué à faire feu de tout bois, Denis Seznec, bien qu’il conteste l’appartenance à son grand-père de cette machine à écrire, tient à démontrer de diverses façons qu’il ne s’agit pas de la machine ayant servi à taper les promesses de vente de Traou-Nez. C’est, selon lui, un policier, ou toute autre personne mal intentionnée, qui l’aurait introduite en secret dans la propriété de Guillaume Seznec pour accabler l’inculpé. Cependant, si la machine saisie n’est pas la bonne, elle peut bien appartenir à Seznec sans qu’elle puisse être retenue comme un élément à charge contre lui. Contester son lien avec l’affaire devrait suffire. Malheureusement, il sera prouvé que cette machine, identifiée par ses défauts caractéristiques, par les traces d’une réparation et par son numéro de série, est bien celle qui a été utilisée pour façonner les deux exemplaires de la promesse de vente datée du 22 mai 1923, et qu’étrangement elle n’a été achetée que trois semaines après cette date par un sosie de Seznec, si ressemblant que plusieurs témoins, mis en présence de Seznec, le reconnaîtront formellement comme l’acheteur.
La principale source de Denis Seznec pour ses pages consacrées à cette troisième perquisition est, de manière évidente, un article de La Dépêche de Brest du 8 juillet 1923, qui sera en grande partie reproduit, légèrement modifié, dans Le Journal du lendemain (mais la réaction d’Angèle Labigou ne figure pas dans cette seconde version) :
C’est la machine à écrire ! Bien vite, elle apparaît toute nette, comme neuve, sans la moindre poussière.
— Je ne sais pas, répond Mme Seznec, lorsqu’on l’interroge sur la présence de cet objet en ce lieu.
Néanmoins, on la presse de questions.
— Jamais je n’ai vu ici cette machine et jamais mon mari ne m’en a parlé. Ce n’est certainement pas lui qui l’a portée là.
Un inspecteur de la brigade mobile, pour procéder aux premières vérifications, s’est servi de l’instrument pour taper le début de l’acte sous seing privé qui fut reproduit par la presse. Or, il lui apparaît ainsi qu’à ses collègues que les empreintes sont identiques.
Mme Seznec n’en proteste pas moins.
— Mon mari, dit-elle, ne sait pas se servir d’une machine à écrire ; de plus, j’ai très nettement remarqué que dans l’acte qu’il m’avait remis après qu’il eut été signé à Brest par M. Quéméneur, il y avait des lettres rouges. Or, ici, il n’y en a pas.
Mlle Angèle, qui, la veille encore, avant l’entrée chez les époux Seznec de ceux qui allaient faire l’importante découverte que l’on sait, nous jurait que jamais elle n’avait vu d’autre machine à écrire que celle qui avait été cédée il y a dix-huit mois environ à un habitant de Morlaix, est également harcelée de questions.
Que sait-elle exactement ? N’est-elle pas plus avertie qu’elle le veut bien dire ? Est-il impossible de le supposer, alors qu’elle vit familièrement chez ses maîtres... si fami[li]èrement même qu’il lui advint un jour de leur prêter plusieurs milliers de francs ?
C’est pourquoi on l’interroge avec autant de soin.
Cette machine ?
Elle non plus ne sait pas ; elle ne l’a jamais vue.
Je constate tout d’abord que, même si l’article ne précise pas la chronologie exacte des faits, les explications de Marie-Jeanne Seznec sont données avant celles d’Angèle Labigou. Denis Seznec nous dit que la perquisition a commencé vers 14 heures, Angèle étant seule à la maison, que Marie-Jeanne n’est arrivée qu’une heure plus tard et que la découverte de la machine s’est faite en l’absence de la maîtresse des lieux. C’est probablement la raison pour laquelle il préfère placer la réaction de Marie-Jeanne après celle d’Angèle. Or, l’article de La Dépêche de Brest montre que la fouille dans la machinerie n’a été effectuée qu’après de longs efforts fournis ailleurs, qui peuvent avoir pris des heures (j’ajoute des dates entre crochets pour éclaircissement) :
Des recherches avaient déjà été faites en ce lieu [les 28 et 30 juin], mais on les voulait plus complètes encore.
On avait sondé le lit du Queffleut et la vase de l’étroit canal latéral [le 30 juin] ; on voulait tout examiner maintenant [6 juillet]. Et d’un hangar où s’entassaient mille choses, on sortait par centaines des vestes et des capotes militaires ; une à une, on soulevait les plaques des canalisations, on déclouait des planches formant plafonds ou planchers, on vidait le foyer de la chaudière de l’appareil moteur et on examinait les cendres.
Bien que tout cela fût vain, les recherches se poursuivaient avec la même ardeur.
Derrière la haute chaudière, un escalier entièrement fait de tiges métalliques grimpe entre des cloisons de briques. On le suit jusqu’au premier étage, où l’on perquisitionne à nouveau, sans plus de résultat ; on le reprend encore pour gagner la soupente qu’éclairent deux ou trois pauvres lucarnes.
Ici, un ramassis de choses les plus hétéroclites : des ustensiles de toutes sortes, des sabots inachevés, des fils électriques, des bouts de ferraille sans nom, et derrière une sorte de cloison, un lit fait de planches juxtaposées que le rabot n’a même pas effleuré. Ce coin représente la chambre qu’occupait un chauffeur, il y a un an !
Toute la literie y est demeurée. Son examen ne révèle rien.
À côté, appuyé sur la muraille, un large tableau vernissé, percé de trous, par où émergeaient jadis des fils électriques. Un geste le relève et derrière apparaît un paquet fait de papier gris.
Puisque l’on imagine mal madame Seznec suivant les inspecteurs dans un grenier, au sommet d’un escalier fait de tiges métalliques (qui semble permanent et éliminerait ainsi ce qu’a écrit Yves Le Saout sur la nécessité d’apporter une échelle), la découverte ne s’est certainement pas faite sous ses yeux, mais sa présence à son domicile n’est pas exclue, car elle semble avoir été interrogée sur la provenance de la machine peu de temps après.
Denis Seznec, lui, ignore les centaines de pièces de vêtements transportées, les canalisations inspectées, les plafonds et planchers décloués et l’examen des cendres de la chaudière, et nous résume les recherches à sa façon (page 171) :
Les policiers, contrairement aux visites précédentes où ils ont fouillé partout de fond en comble, un peu au hasard, se dirigent sans aucune hésitation vers un hangar. Ce bâtiment, qui n’a bien sûr pas échappé aux recherches antérieures, abrite la machine alimentant la scierie en énergie.
Négligeant le rez-de-chaussée, l’escouade monte directement au premier étage où se trouve l’ancienne chambre du « chauffeur », Raymond Samson.
Il n’y a pratiquement pas un mot de vrai dans cette description.
Mais revenons au sujet de ce billet (dont il est difficile de ne pas s’écarter régulièrement, chaque phrase de Denis Seznec étant sujette à caution). Dans La Dépêche de Brest, Marie-Jeanne ne parle pas de « lettres avec des traces rouges » (ce qui n’a aucun sens) mais de « lettres rouges », qu’elle a vues sur l’acte que son mari lui a présenté (prétendument le 22 mai en rentrant de Brest, quand la machine qui l’a tapé était encore au Havre chez Joseph Chenouard, qui l’avait acquise le 13 avril), et elle ne dit pas que le ruban de la machine saisie est noir, mais seulement qu’il n’y a pas de lettres rouges sur la copie faite par le policier, alors que l’acte en question était bicolore, les prix et le pourcentage des intérêts étant tapés en rouge.
La présence de ce ruban noir est donc une invention de Denis Seznec, due à une mauvaise interprétation de l’article de La Dépêche de Brest. De plus, si la machine à écrire découverte au domicile de Guillaume Seznec avait été équipée d’un ruban noir, ou vert, ou jaune, ou n’avait pas eu de ruban du tout, cela n’aurait en aucun cas empêché quelqu’un de taper les promesses de vente sur cette machine avec un ruban bicolore à une date antérieure.
Ce ruban noir est d’autant plus une invention que le 13 juin 1923, la machine à écrire ayant servi à taper les promesses de vente était équipée d’un ruban bleu et rouge,
Extrait de la déposition de M. Chenouard devant le juge Campion le 25 juillet 1923, telle qu’elle est rapportée dans Le Journal du lendemain :
Lorsque mon mystérieux client, dit-il, eut examiné la machine qu’il désirait acheter, il s’aperçut qu’elle portait un ruban bleu unicolore. Il me demanda si on ne pouvait enlever ce ruban et le remplacer par un ruban bleu et rouge. Le changement fut fait sur-le-champ. Or, cette machine (il la désigne) a bien, comme vous pouvez le constater, un ruban bicolore.
Quand l’opération fut terminée, mon client tata les touches de l’instrument et se plaignit de la dureté de leur déclenchement. Je lui proposai alors d’essayer la machine lui-même, mais il me répondit vivement : « Inutile, je ne sais pas m’en servir. Ce n’est pas pour moi, mais pour ma fille que je l’achète. »
Enfin, au moment de payer, il me fit établir une facture au nom de M. Ferbourg, demeurant à Mayenne.
Le Petit Parisien du même jour :
Son client a longuement examiné l’appareil, il a commencé par se plaindre que les caractères étaient trop petits.
— Il y avait chez moi, poursuit le commerçant, M. de Hainaut qui, je crois, avait fait précisément le voyage de Paris au Havre avec ce client. M. de Hainaut fit observer que les lettres, bien que petites, étaient très lisibles, et qu’au contraire, leur dimension était un avantage, car il y en avait plus à la ligne.
Mon client tapota alors sur le clavier et se plaignit que la machine était un peu dure.
— Essayez d’écrire, lui répondis-je, et vous verrez que vous vous trompez.
— Oh ! non, me répondit-il, je ne sais pas taper. C’est pour ma fille qui apprend.
Cependant, un peu après, il demanda un ruban bicolore bleu et rouge, celui installé sur la machine était uniformément bleu. Cela m’a semblé bizarre tant pour le mot employé que par ce que mon acheteur venait de me dire.
Peu importe, en effet, pour un apprentissage, qu’on tape en bleu ou en rouge.
Le Gaulois du même jour :
À 9 heures, M. Chenouard fut introduit dans le cabinet du juge et mis en présence de la machine à écrire trouvée dans un grenier chez Sezenec. M. Chenouard n’eut pas la moindre hésitation :
« Je reconnais parfaitement cette machine pour être celle que j’ai vendue à l’homme qui vint me voir le 13 juin. Elle porte tout d’abord le matricule dont la « Guaranty Trust », qui me l’avait vendue, avait eu soin de prendre note. Puis j’y retrou[v]e le défaut qui avait nécessité une réparation à la crémaillère du chariot. Enfin, je constate également que les lettres présentent les mêmes particularités que celles de la machine à écrire qui a servi à taper l’acte de vente de la propriété de Plourivo. C’est bien la machine que je vendis dans les circonstances que j’ai déjà indiquées.
» Lorsque l’homme se présenta chez moi, MM. Dehainaut et Legrand se trouvaient au magasin. Comme le client, après avoir demandé une petite machine portative, discutait du prix et en demandait une autre d’occasion, Mlle Héronval m’appela, et c’est alors que j’offris la machine que voilà.
» — Le ruban est unicolore, me dit l’acheteur, j’en voudrais un bicolore, et, pour le satisfaire, on en mit un rouge et bleu.
» — Les caractères sont bien petits, dit-il encore.
» M. Dehainaut intervenant alors, lui fit remarquer qu’on avait ainsi l’avantage de pouvoir réunir plus de lettres dans une ligne et que la dactylographie était tout aussi lisible.
» — Les touches sont dures, me fit remarquer l’inconnu, après en avoir actionné quelques-unes.
» — Pas plus que les autres, lui répondis-je.
» — Après tout, cela m’est égal, car ce n’est pas moi qui m’en servirai. Je ne sais pas me servir de la machine. Elle est destinée à ma fille. »
M. Dehainaut, entendu ensuite, confirma ces déclarations.
Il en fut de même pour M. Legrand et pour Mlle Héronval.
Puisque cette audition de Joseph Chenouard nous est rapportée par la presse et que, malgré ces récits concordants, certains n’accordent guère de crédit aux propos des journalistes, voyons ce que nous dit l’avocat Dominique Inchauspé, qui a minutieusement étudié le dossier, à propos du détail qui nous occupe, dans son livre L’Erreur judiciaire (2010) :
La machine que le juge montre à Chénouard présente un ruban bicolore et violet que le client/Seznec avait demandé à Chénouard de mettre à la place du ruban d’origine.
Bien entendu, « bicolore et violet » est une expression incorrecte ; il peut s’agir d’une faute d’impression, pour « bicolore, rouge et violet ». Quoi qu’il en soit, Dominique Inchauspé n’a certainement pas inventé la seule couleur qu’il mentionne, et on peut en déduire que le procès-verbal de l’audition de Joseph Chenouard considérait comme violet ce que ce marchand de machines à écrire, selon les journaux, appelait bleu.
Quant à l’acte d’accusation du procureur général Guillot en date du 13 août 1924, il ne retient que l’adjectif « bicolore » :
L’identité de cette machine avec celle vendue par CHENOUARD est cependant clairement démontrée. Elle résulte et de sa marque « Royal », type 10, n° X 434.080, caractère « Elite » et d’une réparation dont la trace se voit encore sur le côté gauche du chariot et que CHENOUARD avait annoncée et décrite dès avant qu’on la lui présentât, et d’un ruban bicolore dans lequel CHENOUARD a reconnu celui-là même qu’il y avait adapté sur le désir express de SEZNEC, et de la présence, à l’endroit de la trouvaille, du papier d’emballage dont elle avait été enveloppée et qui est précisément celui en usage dans le magasin de CHENOUARD.
CONCLUSION
J’ai écrit l’essentiel de l’article ci-dessus dans les premiers jours de juillet 2020. Je n’ai fait, pour le présenter aujourd’hui, qu’ajouter quelques phrases pour introduire les deux dernières citations. On peut en résumer les éléments ainsi : c’est à la demande de l’acheteur (Guillaume Seznec, selon les témoins) que la machine à écrire ayant servi à taper les promesses de vente a été équipée d’un ruban bicolore, violet et rouge, le 13 juin 1923, et ce ruban était toujours présent sur la machine le 25 juillet 1923, quand elle a été formellement identifiée par Joseph Chenouard. L’article de La Dépêche de Brest du 8 juillet 1923 dit seulement que Marie-Jeanne Seznec remarque l’absence de lettres rouges dans la copie de l’acte faite par les policiers avec la machine qu’ils viennent de saisir chez elle. Il n’évoque pas le ruban et ne précise pas si cette copie est noire, bleue ou violette. En toute logique, le ruban est au moment de la saisie le même que le 13 juin et le 25 juillet, mais les policiers n’ont tout simplement pas su ou pas pensé à utiliser la seconde couleur pour certains mots dans leur copie, qui n’est qu’une rapide vérification et n’a pas la valeur d’une expertise. Pour changer de couleur, il faut activer un mécanisme qui relève ou abaisse le ruban afin que les caractères frappent la partie du ruban ayant la couleur souhaitée.
Concernant la nuance entre bleu et violet, on peut voir sur le site de Charlie Foxtrot Typewriters un texte écrit en bleu marine puis en violet ; la différence n’est pas énorme. Enfin, une très belle vidéo sur YouTube nous montre une Royal 10 de 1923 équipée d’un ruban bicolore, noir et rouge.
Billet précédent : Des nouvelles